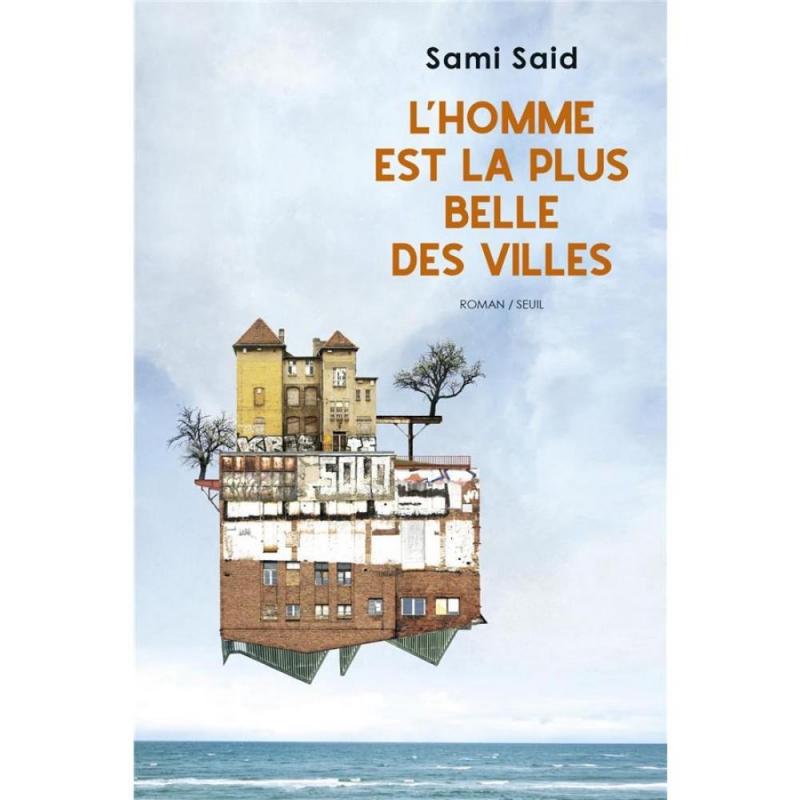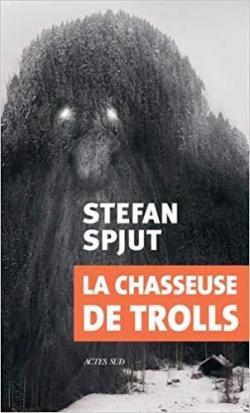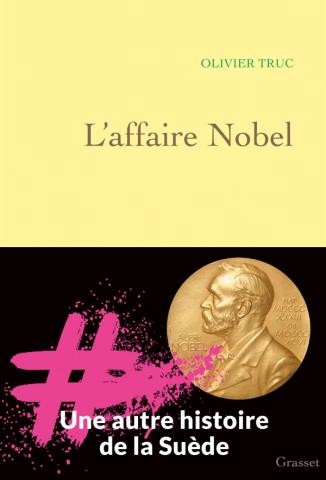S-T
Strindberg, L’Impersonnel

« L’arbre Mademoiselle Julie (…) nous cache la forêt extrêmement étendue, variée et diverse de la production dramatique et romanesque de l’auteur. C’est cette légende noire que je voudrais essayer de dissiper. C’est de ce procès en folie – comme il en existe en sorcellerie – que j’entreprends ici de faire appel », annonce Jean-Pierre Sarrazac (né en 1946, auteur d’essais et de pièces et professeur émérite à la Sorbonne nouvelle), dans son introduction au remarquable essai qu’il consacre à Strindberg, L’impersonnel. Sur August Strindberg, l’un des esprits les plus novateurs et les plus éclairants du tournant du XIXeet XXesiècle, tout et son contraire a été dit. L’ambition de Jean-Pierre Sarrazac de rectifier le tir ne saurait déplaire. Il s’élève ainsi contre Karl Jaspers (auteur en 1953 d’un essai consacré à Strindberg et Van Gogh) et Arthur Adamov (auteur d’un Strindberg en 1955) qui, tous deux, ont accrédité le mythe d’un écrivain en proie à la folie et incapable après Inferno(1897) de renouveler son art, notamment son théâtre. Il montre aussi la filiation perceptible entre le Strindberg du Fils de la servante et le Jules Vallès de la trilogie Jacques Vingtras. Explicitant comment l’auteur met en place dans ses pièces un « véritable système de la cruauté », il affirme que Strindberg invente de fait un « théâtre de combat ». Plus loin, Jean-Pierre Sarrazac atteste combien est fausse l’idée selon laquelle Strindberg et Ibsen s’opposaient, l’un machiste et l’autre féministe. Leurs différends prennent plutôt ancrage dans leur conception formelle du drame – forte empathie du Suédois pour ses personnages, « position très en surplomb par rapport à ses créatures » chez « son grand rival ». Ibsen le construction et Strindberg le démolisseur ? Passionnant est donc cet essai, tant par les perspectives qu’il ouvre, et notamment ce besoin de relire Strindberg, que par les avis qu’il formule.
* Jean-Pierre Sarrazac, Strindberg, L’Impersonnel, L’Arche (Les grands dramaturges), 2018
L’Homme est la plus belle des villes
Ce livre de Sami Said (né en 1979 en Érythrée), L’Homme est la plus belle des villes, est plutôt un beau texte. Une voix intérieure parle de l’exil – cette vie de souffrance qui le précède, la plupart du temps, et cette vie d’incertitude qui lui succède. Le narrateur se nomme San Francisco et vient d’Afrique noire. Il réside aujourd’hui dans un pays d’Europe du Nord. La Suède ? Le premier reproche que nous (dans le cadre de ce site consacré à la littérature des pays nordiques) pouvons faire à ce livre est qu’il pourrait prendre un tout autre lieu pour cadre : un autre pays d’Europe, voire d’Amérique du Nord. Le deuxième, c’est qu’il parle de la condition des migrants avec moult précisions tout en parvenant à demeurer dans le vague. On les voit vivre sous le règne d’un dictateur avec des légions de « Coqs noirs », fuir, tomber entre les mains, pour l’un, d’une « Madame » conciliante et fantasque, pour un autre, de brutes qui le pourchassent, comme si tout cela s’inscrivait dans un rêve. Un triste rêve, où l’on est vite pris pour ce qu’on n’est pas – un « livreur », un déménageur, par exemple. « C’est vrai que le monde est un endroit inquiétant, mais ça n’a rien d’un scoop et il ne faut pas oublier qu’il contient aussi de belles choses. » Nos reproches ne sont pas importants, l’ensemble se lit bien, une belle poésie imprègne ce récit – plutôt qu’un roman.
* Sami Said, L’Homme est la plus belle des villes (Människan är den vackraste staden, 2018), trad. Marianne Ségol-Samoy, Seuil (Cadre vert), 2020
Gouttes de l’océan populaire

Ce titre de Maria Sandel, Gouttes de l’océan populaire, relève-t-il du roman policier ? Tout au moins la quatrième de couverture peut-elle le laisser présumer : « À l’aube des années 1920, à Stockholm, une jeune ouvrière séduite, déshonorée et dépouillée par un voyou de la pire espèce, trouve refuge auprès d’une veuve et de son fils dans un petit appartement d’un quartier pauvre. Là, tout en méditant sa vengeance, elle se reconstruit lentement en s’intégrant à un petit cercle de femmes essayant de vivre heureuses malgré les excès et la brutalité des hommes... » Maria Sandel (1870-1927) fait partie de la première vague d’écrivains prolétariens suédois, de la génération de Dan Andersson et de Martin Koch. Autodidacte (elle travaille dès l’âge de douze ans), soucieuse de voir les libertés fondamentales se répandre, elle publie son premier volume, un recueil de nouvelles intitulé Vid svältgränsen (Au bord de la famine), en 1908. Les accents féministes de ses écrits inscrivent son œuvre dans une période d’acquisition de droits nouveaux pour les femmes. « Allez savoir ce que nous réserve l’avenir ? La Science trouvera peut-être une solution qui fera qu’un jour les hommes seront superflus », interroge l’un des personnages de ce roman au ton très moderne. Des questions importantes sont soulevées, qui un siècle plus tard conservent leur pertinence : la place des femmes dans la société, le salariat, l’homosexualité, le viol, etc. « Gerd et elle sont peut-être un peu vieux jeu avec leur besoin d’être vraiment libres et indépendantes, de penser par elles-mêmes, de vivre à leur guise tout en faisant preuve de grande probité en toute circonstance. » Observons que ce roman, Gouttes de l’océan populaire, est accompagné de nombreuses notes, qui permettent de mieux comprendre un texte fortement ancré dans son époque – sans pourtant jamais dater. Maria Sandel « a vécu pauvre toute sa vie et ne s’est jamais mariée », est-il écrit dans la présentation de l’auteure en début d’ouvrage. Saluons Vincent Dulac, traducteur-éditeur, de proposer aux lecteurs français cet excellent titre, avant de lui suggérer de s’intéresser à d’autres ouvrages de Maria Sandel, si enthousiasmante (mais l’idée lui est venue avant que nous ne la lui soumettions, puisque des nouvelles de Maria Sandel sont annoncées). Les éditions Cupidus Legendi commencent à posséder un véritable catalogue (six titres, tous de valeur). On en redemande.
* Maria Sandel, Gouttes de l’océan populaire (Droppar i folkhavet, 1924), trad. Vincent Dulac, Cupidus Legendi, 2021
Chroniques de Gasviken

Il est rare qu’un roman soit d’abord publié dans une version traduite. C’est pourtant ce qui est arrivé aux Chroniques de Gåsviken (éd. de l’Élan) de Olle Schmidt, puisque le livre a d’abord vu le jour en français (traduit par Alain Bourges) avant d’être disponible en suédois (chez le même éditeur, mais dans un format différent) et de récupérer ainsi son titre d’origine : Krönika från Gåsviken. Enseignant à la retraite, domicilié près d’Östersund, dans la région du Jämtland, Olle Schmidt s’est attaché à présenter ici la commune qui l’a accueilli avec son épouse puis leurs enfants, lorsque, dans les années 1970, ils ont décidé de faire une sorte de « retour à la terre ». Si les noms de lieux de ces Chroniques de Gåsviken (la baie de l’oie) sont inventés, ils sont facilement repérables sur une carte. Apparaissent quantité de personnages graves ou loufoques qui peuplent la campagne suédoise (on n’est pas très loin, dans les descriptions, de l’atmosphère des albums de Sven Nordqvist). Il y a cet antiquaire venu de Stockholm, par exemple, qui méprise tout le monde mais achète pour quelques couronnes et revend à prix d’or verrerie et meubles anciens... ; ou ces Éthiopiens cueilleurs de mûres polaires, confrontés au climat parfois rude, à l’immensité des forêts et surtout aux moustiques… Oscillant entre humour et nostalgie, ou plutôt conjuguant sans cesse les deux, Chroniques de Gåsviken peut se révéler, pour des novices prêts à sortir des sentiers battus, une excellente introduction au voyage en Suède.
* Olle Schmidt, Les Chroniques de Gåsviken , trad. Alain Bourges, éd. de l’Élan
Les Survivants
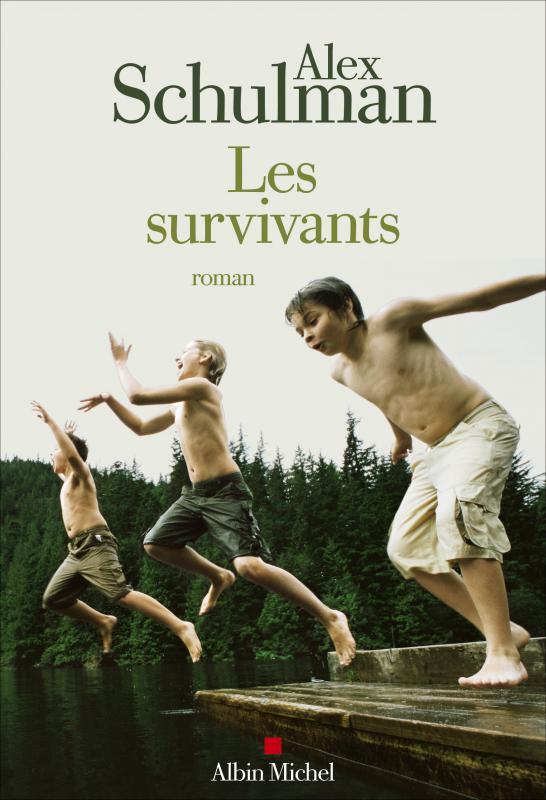
Présenté à grand renfort de superlatifs (notamment sur la jaquette de couverture, avec des extraits de la presse internationale, excusez du peu), Les Survivants, de Alex Schulman (né en 1976, journaliste, homme de médias), est un roman quelque peu décevant. Nils, Benjamin et Pierre, respectivement âgés de treize, neuf et sept ans dans les premières pages, sont trois frères élevés par un père et une mère plus prompts à vider un verre qu’à veiller sur eux. L’entente fraternelle résiste cependant face à ces parents bohèmes, la vie à la campagne leur apporte nombre de satisfactions. « ...Quand ils jouaient au football ou aux cartes, leurs parties dégénéraient parfois en de telles bagarres que Benjamin sentait quelque chose se briser entre eux. » Les événements, ici ces petits riens du quotidien à l’exception de cette catastrophe qu’une thérapeute finit par mettre en lumière, ne les éloignent pourtant pas, jusqu’à l’âge adulte. Mais quand leur mère décède, longtemps après leur père, qu’ils décident de jeter ses cendres au bord du lac, une vérité qu’ils ont tue éclate soudain. Le lecteur découvre le sens du titre. Et comprend que quelque chose lui a échappé depuis le début. De ce point de vue ce roman est réussi. Mais reprendre le livre en main n’apporte pas grand-chose, on se demande même pourquoi la police est présente dès les premières pages. « ...Benjamin sentit son cœur battre plus vite (…), il identifia un sentiment envers sa mère que jamais auparavant il n’avait laissé émerger. La colère. Il n’avait fallu qu’une petite étincelle, une étincelle qui avait mis le feu aux poudres. » Taisons notre enthousiasme mitigé... !
* Alex Schulman, Les Survivants (Överlevarna, 2020), trad. Anne Karila, Albin Michel (Les Grandes traductions), 2022
Prochain arrêt

Alex Schulman (né à Skåne en 1976), Prochain arrêt : Cinq voyageurs se retrouvent dans le train pour Malma, « un petit village au milieu de nulle part, une gare de chemin de fer et une rue avec des réverbères pareils à une rangée de lunes suspendues, une côte à travers bois ». Harriet, une fillette d’une petite dizaine d’années, et son père, qui appelle tout et n’importe quoi « un type » ; Oskar et sa compagne, « immature et inintéressante », laquelle semble mentir plus souvent qu’un arracheur de dents ; et Yana, qui n’a pas pu rendre une dernière visite à son père, qui vient de mourir et qu’elle n’avait pas vu depuis des années : « Il y avait quelque chose d’explosif chez papa, il valait mieux se méfier ». Ces personnages se dessinent vite et très nettement chez le lecteur et pourtant, quelques pages plus loin, le doute le saisit : qui est qui ? Quelque chose relie leur voyage – mais s’agit-il du même voyage ? Ils ne se rendent pas à Malma, une localité improbable de Suède, par hasard et leurs motivations se rejoignent, dictées par leur histoire personnelle. Le roman est au présent mais l’intrigue est comme emmêlée dans des boucles temporelles. « Où allez-vous ? Yana marche juste derrière eux, elle entend la fillette respirer et se racler la gorge nerveusement, elle doit ralentir l’allure pour ne pas lui marcher sur les talons. » Les faits se rejoignent, donnent l’impression de se répéter. Le lecteur va découvrir que l’enfant d’hier est l’adulte d’aujourd’hui, et que ces cinq partagent bien des secrets. Amour et haine s’affrontent. Un roman subtil, déroutant, un bel exercice de style, ce qui est déjà pas mal.
* Alex Schulman, Prochain arrêt (Malma station, 2022), trad. du suédois Anne Karila, Albin Michel, 2024
Les Élus
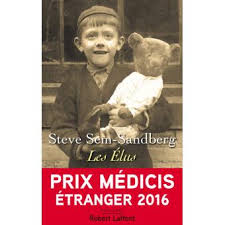
Vienne (Autriche), 1941, 1943... L’hôpital du Spiegelgrund est à présent une institution dirigée par les nazis, qui accueille des enfants handicapés et jeunes délinquants. Autrement dit, des enfants handicapés mentaux, souvent, et des « marginaux ». Anna Katschenka est employée comme infirmière et découvre peu à peu le sort qui leur est réservé. Le régime nazi les considère comme irrécupérables et l’euthanasie les attend : « uniquement quand le retard mental ou les tares héréditaires et raciales de l’enfant sont telles qu’il n’en résultera qu’une succession sans fin de souffrances et d’humiliations pour toutes les parties concernées. » Anna « trouvait cette pratique étrange et répugnante, ce qui ne l’empêchait pas d’accomplir son travail », puisque « les enfants jugés inaptes à survivre » ont aussi besoin de soin et de nourriture. Hedwig Bley, une autre infirmière, tente, elle, avec à peine moins de « dureté sous (sa) douceur apparente », d’assister les enfants ou tout au moins certains d’entre eux comme elle le peut, prêtant ainsi le flanc au zèle de ses collègues et de sa hiérarchie, tous nazis et donc acquis à l’idée que ces enfants doivent mourir : « …il avait été clair dès le début qu’on donnait intentionnellement la mort aux enfants, même si personne n’osait le dire franchement… ». La guerre finie, certains se retrouveront face aux juges, d’autres passeront entre les mailles des filets et continueront à sévir, autrement, tous convaincus, ou ils l’affirmèrent, d’avoir agi comme ils devaient le faire. Ouvrage romancé, mais à la limite du reportage et de la fiction (on peut songer, pour cette façon de procéder, à un autre écrivain suédois, Sven Lindqvist), basé sur une importante documentation, Les Élus, a reçu de nombreux prix en Suède (Prix August), en France (Prix Médicis étranger) et ailleurs. Steve Sem-Sandberg (né en 1958, romancier, d’abord de science-fiction, journaliste et traducteur) suit le parcours de plusieurs de ces enfants, dont Adrian, âgé d’une dizaine d’années, qui n’avaient pas de place dans le régime d’abjection alors en vigueur dans nombre de pays d’Europe. – Les Élus sont les enfants qui vont mourir en priorité. La maladie, selon la terminologie nazie, les touchait bien logiquement au premier chef. « Les recherches en génétique ont clairement démontré qu’il n’existe aucune maladie affectant l’organisme – pas même une banale infection – qui ne comporte une composante héréditaire. » Et l’on en revenait aux origines « sociales et raciales » du patient, justifiant les « coups de fouet » et l’eugénisme, comme l’affirmait à l’époque, à l’instar de nombreux autres médecins, le Prix Nobel de médecine (1912) Alexis Carell dans son best-seller, L’Homme, cet inconnu (1935) : la supériorité d’une « race » et l’élimination des individus qui n’en faisaient pas partie et des « déviants ». Le traitement réservé à ces enfants est terrible et la lecture de ce livre souvent insoutenable. Comme dans son précédent ouvrage, Les Dépossédés (qui s’attachait au parcours très controversé de Mordechai Chaim Rumkowski, président du Conseil juif et à la tête, de 1940 à 1944, du ghetto de Lódz, contrôlé en réalité par l’administration allemande), Steve Sem-Sandberg, en redonnant ici vie à ces enfants sacrifiés sur l’autel du nazisme, fait de nouveau œuvre salutaire. « Les morts ne meurent pas seulement une fois. Ils meurent éternellement. » Souhaitons qu’il soit entendu à jamais.
* Steve Sem-Sandberg, Les Élus (De utvalda, 2014), trad. Johanna Chatellard-Schapira & Emmanuel Curtil, Robert Laffont (Pavillons), 2016
W. ou la guerre

Steve Sem-Sandberg a déjà signé trois ouvrages, traduits en français, de très haute tenue : Les Dépossédés, Les Élus et Lettres de pluie. Celui-ci, W. ou la guerre, comblera de nouveau les lecteurs exigeants. La guerre, celle d’autrefois, à pied ou à cheval et avec des armes qui ne peuvent que sembler rustiques à l’heure de l’armement nucléaire, est décrite longuement, jusque dans les moindres détails. De quoi appréhender l’humain avec une légère défiance. « Prions ensemble le Seigneur tout-puissant. C’est entre Ses mains que repose notre destin », conseille l’aumônier (« le Tourment ») à Johann Christian Woyzeck (ou Woyetz, ou plus simplement... W.), journalier puis soldat, accusé d’avoir tué en pleine rue Johanna Christiana Woost, sa peu farouche maîtresse, et bientôt condamné à mort. Nous sommes en Allemagne, en 1821. Sur l’injonction d’un procureur, cette « âme simple qui est souvent la proie de ses émotions » raconte son existence. Celle d’un humble, né pour obéir sans se poser jamais de questions, dont la vie n’est qu’une plaie. Ses émotions, notamment en direction de la gente féminine, le dépassent souvent. Mais comment ne serait-il pas traumatisé, à la suite des événements qui se sont accumulés dans son existence quasi-animale ? W. parcourt l’Europe du Nord, du début du XIXe siècle, d’une guerre à une autre, dans des conditions effroyables. « Cette déraison infinie sans cesse à l’œuvre est-elle l’ordre fondamental qui régit le monde ? » Ce roman a reçu le prix August en Suède, récompense prestigieuse grandement méritée.
* Steve Sem-Sandberg, W. ou la guerre (W., 2019), trad. Hélène Hervieu, Robert Laffont (Pavillons), 2022
Lettres de pluie
« La clé tourne difficilement dans la serrure. Alors je donne un coup d’épaule dans la porte, qui cède dans un bruit de bois brisé, et j’atterris dans l’obscurité poussiéreuse remplie de l’odeur familière de moisi et de mazout. Me voilà de retour à la maison. » Ainsi commence le récit d’Andreas, qui rentre là où ce n’est plus chez lui, après des années passées au loin. Peu de choses ont changé sur cette petite île au large de la Norvège. Le pont avec le continent a été construit il y a déjà si longtemps. Andreas retrouve les uns et les autres, les survivants d’un temps pas tout à fait disparu. Minna et lui étaient les enfants d’un couple d’Américains mystérieusement disparus en 1963, le père fut un héros de la Seconde Guerre mondiale. Ou c’est ce qu’on lui a toujours dit, peut-être pas la vérité. Les enfants ont été placés chez Johannes, alcoolique et pro-Allemand durant le conflit. C’est de la Maison jaune, celle de Johannes, que Andreas va peut-être hériter. Mais il n’en est pas sûr, Johannes n’a jamais officiellement adopté les deux orphelins. Les souvenirs remontent, rien n’est clair. Entre Johannes et Minna, Andreas s’est laissé porter par la vie, n’en tirant qu’un bilan sombre. Aujourd’hui, il a l’impression que « toute l’île (le) suit des yeux », que les oppositions d’hier ne sont pas apaisées. Pour preuve, cette bande d’adolescents qui met le feu à sa maison. Steve Sem-Sandberg a publié deux livres puissants, Les Dépossédés et Les Élus, prenant la Deuxième Guerre mondiale pour cadre. Lettres de pluie traite, en partie, de la même période, revient sur des faits de semblable nature, mais, œuvre de fiction, se veut plus romancé. L’ambiguïté des comportements face aux événements tisse l’intrigue de ce roman – presque un policier, avec crimes et enquête. Différentes strates de lecture déstabilisent le lecteur.
* Steve Sem-Sandberg, Lettres de pluie (Stormen en berättelse, 2016), trad. Johanna Chatellard-Schapira, Robert Laffont (Pavillons), 2019
La Gouvernante suédoise
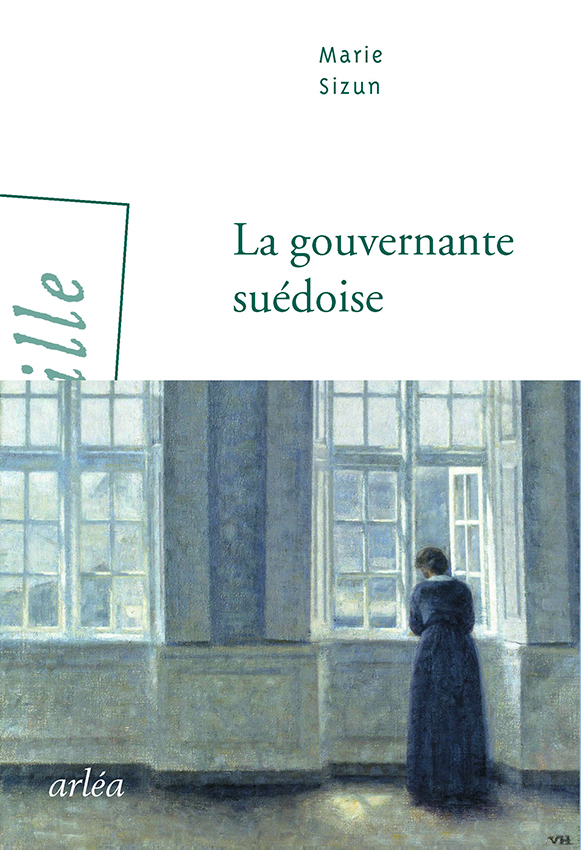
La Gouvernante suédoise est un beau roman dont l’action se situe d’abord en Suède, puis en France. Marie Sizun, l’auteure (née en 1940), Française, en est la narratrice. « …Cette histoire il me faut la raconter, parce qu’elle m’appartient, ou plutôt parce que, d’étrange façon, j’ai le sentiment d’être cette histoire », précise-t-elle d’emblée. Milieu du XIXe siècle. Léonard Sèzeneau, professeur de lettres, est marié à une Anglaise, qui l’accompagne en Suède, à Göteborg, où il vient de trouver un poste de conférencier. Il donne également des cours dans la riche famille de son logeur et bientôt, noue une liaison avec Hulda, son élève, de vingt ans sa cadette. Son épouse regagne l’Angleterre. Scandale, mais Hulda attend un enfant et, conciliant malgré tout, le beau-père propose, via des amis, un emploi à Léonard, qui accepte : négociant en vins à Stockholm. La prospérité est au rendez-vous. « On chante très haut les beaux chants de Noël suédois, on boit et on mange, on rit (…), on porte un toast, on joue du piano, on danse, les enfants épuisés finissent par s’endormir sur un sofa. C’est l’image du bonheur, tel qu’on peut la rêver à Noël. Comme une pause étonnante, irréelle, hors du temps. » Hulda a un enfant, puis un deuxième, puis un troisième… Une gouvernante est engagée, Livia, avec laquelle Léonard aura bientôt une relation amoureuse. Quand la famille émigre en France, à Meudon, que Léonard disparaît peu à peu de la vie quotidienne, accaparé par son travail et, Hulda va s’en apercevoir, en manque d’argent, la vie familiale bascule. Le rêve est terminé. La vie en banlieue parisienne est un cauchemar pour la jeune femme, qui devine l’infidélité de son époux mais refuse de l’admettre, et qui de manière déconcertante se rattache à Livia. Cette dernière finit elle-même par être enceinte et cache à tous la naissance de Georges, qu’elle place en nourrice. Marie Sizun trace là plusieurs portraits, qui se croisent, s’entrelacent, évoluent ensemble. Tous, cependant, demeurent énigmatiques. Que sait le lecteur de Léonard, finalement ? De ses pensées et de ses agissements ? Ou de Livia, si froide et pourtant si touchante ? Ses raisons de rester au sein d’une famille en plein délitement ? Et de Hulda ? Cette femme qui ne choisit pas, qui est balloté par la vie. Cette femme, comme une ombre. Beaucoup de pudeur, de sensibilité, dans ce roman, La Gouvernante suédoise.
* Marie Sizun, La Gouvernante suédoise, Arléa (1er mille), 2016
La Troisième île

Il peut sembler étonnant, à la vue de la production éditoriale d’aujourd’hui, qu’un livre comme La Troisième île de Fredrik Sjöberg ait pu être traduit et publié ici. En dépit du titre, il ne s’agit pas là d’un roman – quoi que… – ni d’un essai – encore que… – ni d’une biographie, ni d’une autobiographie. Tout cela à la fois, en revanche. Autrement dit un petit ouvrage qui fait plus ou moins suite à Piège à mouches (Les Allusifs, 1991), bourré de pensée digressives, de réflexions intelligentes, un petit ouvrage débordant d’une érudition qui ne peut que captiver l’esprit le plus rétif à la taxinomie.
« Enfreindre les tabous est devenu une obligation – et aussi une sorte de consolation pour les iconoclastes qui ne peuvent ou n’osent suivre leur propre chemin. Susciter un débat n’est pas sorcier. Même les plus nuls y parviennent, y compris ceux qui travaillent dans la publicité. La beauté, c’est autre chose. S’en approcher, de nos jours, pour un artiste (…) demande souvent des quantités de courage que tous ces contestataires, ces hérauts cyniques de la transgressions, n’arrivent même pas à imaginer. »
* Fredrick Sjöberg, La Troisième île (Russinkungen, 2009), trad. Elena Balzamo, José Corti (Biophilia), 2014
La Petite librairie de Riverside Drive
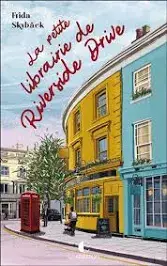
Il y aurait des livres pour les hommes et des livres pour les femmes ? On peut penser dépassée cette vision (alors que l’on parle tant et avec raison d’égalité hommes-femmes), mais des éditeurs l’appliquent toujours, comme Charleston qui entend ne publier des romans qu’à destination des seules lectrices ! Dommage, car un livre comme celui de la Suédoise Frida Skybäck (née en 1980), La Petite librairie de Riverside Drive, est à même de séduire lecteurs et lectrices, d’autant qu’il décline les diverses bonnes raisons de lire (ce qui ne peut pas faire de mal aux hommes, censés lire moins que les femmes). Charlotte se remet de la mort de son compagnon. Elle vit en Suède et dirige C/O Charlotte, une entreprise de cosmétique. Quand un courrier l’informe du décès de sa tante Sara Rydberg, qu’elle n’a jamais vue et qui vivait à Londres, elle apprend que celle-ci lui lègue sa librairie, à Riverside Drive. Reprendre le commerce ne l’intéresse pas, surtout que deux employés l’animent, Martinique et Sam, avec William, un locataire qui se targue d’écrire, sous la vigilance du chat, Tennyson. Convaincue de régler rapidement l’affaire avec le notaire, elle se rend sur place. Et découvre une boutique qui aurait dû depuis longtemps être mise en faillite, mais pleine de charme, où employés et clients ont leurs habitudes et cohabitent en bonne entente. « Si la librairie devait fermer, toute l’œuvre de Sara partirait en fumée. Tout l’amour et toute la chaleur qui faisaient de Riverside un lieu unique voleraient en éclats et aucun souvenir n’y naîtrait plus jamais. » En parallèle, le lecteur suit les premiers pas de Sara dans la capitale anglaise, en 1982, suivie par sa sœur Kristina, la mère de Charlotte. Les deux femmes étaient très proches avant de rompre subitement. Pour quelle raison ? se demande Charlotte. Différentes intrigues se mêlent ici et, si le thème n’est pas des plus originaux, il est bien traité et ce roman est agréable à lire. Puisque « on n’est jamais vraiment seul avec un livre », pourquoi ne pas plonger dans celui-ci ?
* Frida Skybäck, La Petite librairie de Riverside Drive (Bokhandeln på Riverside Drive, 2018), trad. du suédois Sophie Jouffreau, Charleston, 2022
La Chasseuse de trolls
1978, en Suède, région de Falun. Magnus Brodin, un enfant de quatre ans, assure à sa mère avoir vu « une bête » dans la forêt, près de la petite maison avec « l’électricité, mais pas l’eau courante ni les WC » prêtée par un ami, dans laquelle ils séjournent pour les vacances. Peu de temps après, il disparaît. Mona Brodin assure qu’il a été enlevé par « un géant » mais n’est pas prise au sérieux. Au fil du temps, des apparitions de « trolls » sont signalées en différents endroits du pays, dans des zones reculées : vers Jokkmok, Gällivare ou Kiruna. Stefan Spjut (né en 1973) signe avec La Chasseuse de trolls un roman déroutant. L’intrigue est bien conçue et déborde de véridicité, tout au moins dans la première partie. D’autant plus que Spjut se réfère à de véritables cryptozoologues (la cryptozoologie est « l’étude d’animaux dont l’existence n’a pas été prouvée par la science », comme le yéti ou le monstre du Loch-Ness), qui, s’ils ont eu maille à partir avec certains esprits scientifiques, ne possédaient pas moins de solides connaissances sur la faune et la flore. Il n’hésite pas non plus à introduire dans son récit des personnages réels – comme le peintre-illustrateur John Bauer, qui a tant dessiné de trolls ; ou le présentateur radio puis télé Sven Jerring ; ou encore le Prix Nobel de littérature Verner von Heidenstam. « ...Attends-toi à ce que personne ne te croie. » Un roman surprenant, entre fantastique et policier, donné comme le premier tome d’un diptyque, qui peut leurrer facilement le lecteur.
* Stefan Spjut, La Chasseuse de trolls (Stallo, 2012), trad. Jean-Baptiste Coursaud, Actes sud (Exofictions), 2019
Mon frère

L’alcool est peut-être le véritable héros de ce roman, Mon frère, signé Karin Smirnoff (née en 1964). L’alcool, dont plusieurs des personnages s’imprègnent, à commencer par Jana Kippo, de retour dans la commune (fictive) de Smalånger, près d’Umeå. « La Jana d’aujourd’hui est docile et fait ce qu’on lui demande », prévient-elle. On ne sait pas trop le travail qu’elle exerçait avant de descendre du car sur la E4, de marcher jusqu’au village et de retrouver son frère jumeau, Bror. Elle s’installe avec lui dans la maison familiale, puis est embauchée par la commune comme aide à domicile. Elle connaît plus ou moins tout le monde. Ce retour est pour elle l’occasion de ré-affronter ses démons d’autrefois : son père, une brute qui la violait, que Bror a fini par tuer d’un coup de pelle sur le crâne, sa mère, qui ne disait rien, qui approuvait même... « Enchaîner un enfant. Abattre un chiot. Ma haine des parents était si forte et si vive que j’en avais parfois des visions. » Bror boit, tout comme boit John, un voisin, dont elle s’éprend – il peint, il expose et elle va par ce biais renouer avec sa fille, naguère placée dans une famille d’accueil, peu de temps après sa naissance : Jana était si jeune pour s’en occuper. Le lecteur suit Jana dans le village, que le temps égratigne lentement, chez les personnes âgées auxquelles elle prodigue quelques soins (de beaux passages sur cet emploi ingrat), ou lors de parties de chasse avec la gent masculine. « Je n’ai pas d’amis. (…) Je suis jalouse, pingre et envieuse. Je couche sans contraception parce que si je tombais enceinte, je m’en débarrasserais. Je prends plaisir à me venger. Je tire sur des animaux à la saison des amours. (…) Parfois j’ai envie de faire du mal. Je serais vraisemblablement capable de tuer. » Le roman tourne un peu en rond, ce qui est l’intention de l’auteure. Dix ans plus tôt, dix ans plus tard, Jana et les autres ont toute leur place, qui ne change pas. On peut penser à Résine, de la Danoise Anne Riel, ou au roman de Nina Wähä, Au nom des miens. Mêmes lieux en marge du temps, semblables personnages ballottés par des événements qui les dépassent... La violence sourd des comportements les plus anodins. On s’attend toujours au pire. Presque une étude anthropologique. Mon frère est le premier volume d’une trilogie centrée sur Jana Kippo, qui a rencontré un grand et légitime succès en Suède.
* Karin Smirnoff, Mon frère (Jag for ner till bror, 2018), trad. Esther Sermage, JC Lattès, 2021
La Douce indifférence du monde

Un homme donne rendez-vous à une femme au Skogskyrkogården, le grand cimetière de Stockholm : Lena, une actrice d’une trentaine d’années qui a joué le rôle de Mademoiselle Julie, de Strindberg, et qui vit avec un écrivain. Il est écrivain, lui, « ...ou plutôt j’étais écrivain. Je n’ai publié qu’un seul livre, il y a quinze ans de cela », il a connu vingt ans plus tôt une femme, Magdalena, qui avait aussi joué Mademoiselle Julie. Lena ressemble étonnamment à Magdalena, dit-il. Situation troublante, que Peter Stamm (né en 1963 en Suisse et auteur de nombreux romans) utilise pour interroger le lecteur sur les notions de passé et de présent et comment elles se chevauchent. À quoi correspond ce que l’on nomme réalité, jusqu’où celle-ci est-elle fiable. « Vous avez déjà imaginé que tout ne pourrait être qu’illusion ? » Narré d’une façon qui n’est pas sans rappeler celle de l’écrivain autrichien Peter Handke (ce recul, cette implication suggérée plus qu’énoncée), La Douce indifférence du monde est un roman plaisant, déconcertant, qui aurait cependant pu prendre n’importe quelle autre ville que Stockholm pour cadre (rappelons que Paysages aléatoires, du même auteur, se situait en Norvège).
* Peter Stamm, La Douce indifférence du monde(Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt, 2018), trad. de l’allemand Pierre Deshusses, Christian Bourgois, 2018
Sois sage, bordel !
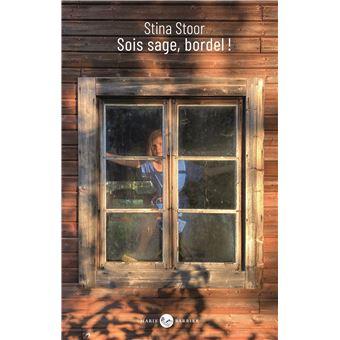
Née en 1982 en Suède, Stina Stoor a déjà reçu quelques distinctions pour ses écrits. La lecture de Sois sage, bordel !, recueil de ses nouvelles publié aujourd’hui en France, permet vite de comprendre pourquoi. Qualité d’écriture et richesse d’émotions s’allient en effet pour produire des textes destinés à s’inscrire dans la mémoire du lecteur – qui peuvent éventuellement faire penser, dans leur noirceur, à certaines pages de Birgitta Trotzig. « Dans les tialles, il restait quelques potentilles et andromèdes fanés. Mais plutôt des lédons, des camarines noires et de ces genévriers qui ont l’air de ramper sur le sol, et puis des bouleaux nains et des touffes de laîches. Et bien sûr des linaigrettes, comme un duvet blanc par endroits sur les bords. Mais surtout les pins qui inclinaient sur la sphaigne rouge et vert leurs ombres tortueuses. » (« L’Âge des ours », une terrible nouvelle sur une fillette abusée par un jeune homme.) N’a-t-on pas l’impression de fouler ce sol et d’en respirer les parfums ? Toutes les nouvelles ici réunies prennent la région de l’Ångermanland pour cadre, autour d’Umeå, et présentent divers personnages, des petites gens toujours, jeunes ou moins jeunes, en proie aux difficultés du quotidien. Le regard de Stina Stoor est pertinent, il n’épargne pas le lecteur. L’auteure n’analyse pas, ou ne le fait pas directement, se contentant de mettre en exergue des situations, d’en souligner l’aspect bucolique qu’elle confronte mine de rien à l’horreur qui les accompagne. Les thèmes peuvent être durs, sans que l’humour les atténue vraiment (« Parcours balisé »). Un style aussi poétique que percutant lie les neuf nouvelles réunies ici, traduites sous la direction de Elena Balzamo. Il semble que Stina Stoor, ait d’ores et déjà renoncé à écrire, annonce Elena Balzamo dans la postface. « On espère qu’elle ne tiendra pas parole : elle a encore beaucoup à dire et son écriture ‘symptomatique’ témoigne d’un immense potentiel narratif. » Une superbe écriture, en effet, une narration tout en finesse : un recueil dont recommander la lecture.
* Stina Stoor, Sois sage, bordel ! (Bli som folk, 2015), trad. sous la direction de Elena Balzamo, Marie Barbier, 2021
Le Ferry

Avec Le Ferry, Mats Strandberg se revendique clairement de Stephen King. Comme son titre le sous-entend, ce roman est un huis-clos prenant un ferry effectuant une traversée entre la Suède et la Finlande pour cadre, avec 1 200 passagers plus les membres de l’équipage. Il s’agit d’un roman, une histoire de vampires en vase clos (mais il n’est bien sûr pas interdit de songer au naufrage de l’Estonia, en 1994 – 852 morts sur ce navire qui rejoignait Tallinn à Stockholm, la plus grande catastrophe maritime en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale). Mats Strandberg présente d’abord les divers personnages qui appareillent pour un aller-retour a priori rapide. « Le ferry est rempli de gens qui, à terre, sont insignifiants, mais qui une fois à bord se comportent en maîtres du monde. » Ambiance glauque dès les premières pages. La traversée est l’occasion pour beaucoup de s’enivrer, et de se trouver une compagne ou un compagnon pour d’autres. Au fil de la soirée, puis de la nuit, l’alcool coule à flots et la situation dégénère. « Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe ici », lance un ancien chanteur de variété reconverti en animateur de soirées karaoké à son public médusé. Les vampires surgissent : « le monde entier parlera de nous demain », dit l’un d’entre eux. D’abord chroniqueur au quotidien Aftonbladet, Mats Standberg (né en 1976) a déjà publié (en traduction française) Le Cercle, Feu et La Clé, trois romans destinés aux adolescents. Le Ferry est un « turn-over » de cinq cents pages auquel le lecteur ne pourra manquer de songer la prochaine fois qu’il sera amené à monter dans un navire de ce type, même pour une très courte traversée. Qui a été mordu ? Qui est devenu un vampire ?
* Mats Strandberg, Le Ferry (Färjan, 2015), trad. Hélène Hervieu, Bragelonne, 2017
Beckomberga, Ode à ma famille
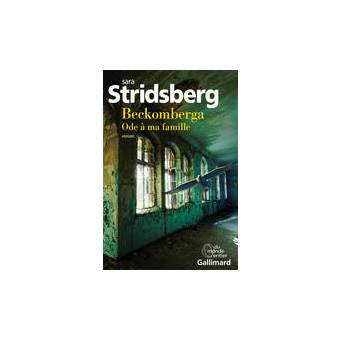
« Personne n’a jamais vraiment cru que Jim deviendrait un vieux monsieur. » Jim (Jimmie) est le père de Jackie et séjourne à Beckomberga, un hôpital psychiatrique aux portes de Stockholm, qui fermera ses portes en 1995 après une petite soixantaine d’années de service. Le roman de Sara Stridsberg (née en 1972) lui redonne vie, contant en parallèle, mais plutôt en creux, la naissance puis l’enfance de Marion, le fils de Jackie. Jim n’est pas à priori un homme des plus sympathiques, lui qui n’aime personne, à l’en croire, mais l’auteure nous restitue son portrait par petites touches, remontant allégrement le temps lorsqu’elle l’estime nécessaire, et finalement ce personnage sait nous émouvoir. N’attendant rien de l’existence, alcoolique, perdant la tête régulièrement, il porte sur le monde un regard somme toute assez pertinent : « …C’est dur de vivre et (…) c’est de plus en plus dur avec le temps. » Ou encore : « …La vie ne commence jamais. Elle termine, c’est tout. D’un coup. » La personnalité de Olof Palme, qui rendait visite chaque jour à sa mère internée ici, trouve cependant grâce à ses yeux et à ceux d’autres patients. Si quelqu’un peut représenter le « dernier espoir », l’heureux changement dans la vie quotidienne, c’est lui, le Premier ministre qui sera bientôt assassiné. Sara Stridsberg décrit un lieu avant de mettre en scène des personnages, Beckomberga n’est pas l’enfer que sont trop souvent les hôpitaux psychiatriques, « ce lieu est un endroit où tout le monde rêve de venir », affirme Jim, c’est comme « rentrer à la maison ». Jackie y passe des heures, même lorsqu’elle ne peut pas voir son père, elle y fait la connaissance d’autres internés, notamment Paul avec qui, bien qu’âgée de quatorze ans, elle noue une relation pas évidente. Sara Stridsberg procède lentement pour peindre cet hôpital, pour montrer quelques membres du personnel et quelques patients. Les saisons défilent, Jackie grandit, s’éloigne de son père, le retrouve. Jusqu’à la mort (suppose le lecteur) de celui-ci. Une mort attendue dès les toutes premières pages et néanmoins affligeante. « Parfois, je me prête à penser que la période de Beckomberga a coïncidé avec celle de l’État providence : de 1932 à 1995 », note Sara Stridsberg à la fin de son livre. Beckomberga, Ode à ma famille est un récit poignant qui ébranle quelques idées toutes faites sur la folie et ses institutions et qui humanise ceux que l’on nomme les « toqués ».
* Sara Stridsberg, Beckomberga, Ode à ma famille (Beckomberga, Ode till min familj, 2014), trad. Jean-Baptiste Coursaud, Gallimard (Du monde entier), 2016
L’Antarctique de l’amour

« Nulle, empotée, molle, godiche, un produit de pacotille sur l’étal bien fourni des filles des années cinquante dont le monde n’avait en fait aucun besoin, qui un jour disparaîtrait sans laisser de traces et ne manquerait à personne. » Ainsi l’héroïne, triste héroïne de ce roman de Sara Stridsberg, L’Antarctique de l’amour, se décrit-elle. Années 1980, une forêt dans les environs de Stockholm. Elle a été victime d’un tueur, qui a découpé son cadavre, elle remonte sa vie jusqu’à ses derniers instants. Ce n’est pas un roman policier, bien que l’intrigue en soit digne. C’est le pendant d’un roman policier – le crime traité du point de vue de la victime. Elle est une victime désignée, si de telles victimes existent : prostituée, camée. Résignée. Ne se plaint pas de ce qui lui arrive. Qu’attendre d’autre de la vie ? Ce roman – puisque Sara Stridsberg assure, à la fin de l’ouvrage, qu’il s’agit-là d’une « fantaisie littéraire » dont tous les personnages « sont fictifs », vient, après Beckomberga (2016), noircir le tableau d’un monde où la cruauté le dispute à la bêtise. « Le chasseur », autrement dit son assassin, « si on lui posait la question, il répondrait qu’il effectue une tâche quelconque que n’importe qui voudrait aussi accomplir : m’atomiser, me réduire à l’état de terre et de sang et de matières d’étoiles, éteindre définitivement toute lumière dans mes yeux. » Car, comme l’écrit encore Sara Stridsberg, « on vit pour l’éternité avec celui qui vous a tuée... » Mais pour quelqu’un de la condition de la narratrice, quelle importance ? L’éternité emporte tout, les injustices et les douleurs. Tout.
* Sara Stridsberg, L’Antarctique de l’amour (Kärlekens Antarktis, 2018), trad. Jean-Baptiste Coursaud, Gallimard (Du monde entier), 2021
Les Gens de Hemsö

Les Gens de Hemsö (Hemsöborna, 1887 ; trad. Jean-Jacques Robert, L’Élan, 2013), de August Strindberg (1849-1912), est un roman qui restitue finement une partie de la société suédoise dans les dernières années du XIXe siècle. Comme à son habitude, l’écrivain aime à porter, ou au moins souligner, le conflit là où celui-ci n’est que sous-jacent. Carlsson, un homme venu d’on ne sait trop où, réhabilite un domaine agricole et, de fait, génère bien des jalousies à son égard. Mais ne les attiserait-il pas volontairement, ces jalousies, pour mieux montrer le ridicule de ses prédécesseurs ? Le combat, c’est certain, ne l’effraie pas. On pourrait même dire que, à l’instar de l’auteur lui-même dont la vie – c’est un euphémisme – ne fut pas de tout repos, il l’apprécie. « Carlsson était un petit Värmlandais trapu aux yeux bleu clair et au nez plus crochu qu’un hameçon. Il ne tenait pas en place, s’étonnait de tout, riait à tout propos et voulait tout savoir, mais il n’entendait rien aux choses de la mer et, si on l’avait fait appeler à Hemsö, c’était pour qu’il prît soin du bétail et des terres dont personne n’avait voulu se charger depuis que le vieux Flod était mort, laissant à sa veuve tout le souci de la ferme. »
Sensations détraquées

En 1894, August Strindberg erre dans les rues de Paris, au désespoir. Son mariage avec Frida Uhl est un échec. Il réside à Versailles et livre ce texte au Figaro : Sensations détraquées, écrit directement en français – comme son récit nommé Inferno, dont Sensations détraquées constitue en quelque sorte l’ébauche. Tout Strindberg est là, l’acuité de sa vision, l’originalité de ses réflexions, sa démesure aussi, son intelligence et son outrance, tout apparaît dans ce texte aujourd’hui joliment publié par les éditions du Chemin de fer, sur papier bleu, et illustré par Renaud Buénerd. « …C’est bien comme cela que j’ai rêvé la Ville, la grande ville, la plus grande ville du monde, enveloppée dans le blanc et chaste nuage qui cache les petites maisons sales des acheteurs et des vendeurs : Paris !... C’est vraiment Paris… que je salue ! » Un Paris que l’écrivain a su faire sien et qu’il fait rimer ici avec folie, une folie à partager.
* August Strindberg, Sensations détraquées (ill. Renaud Buénerd), Le Chemin de fer, 2016
Un Système d’une beauté aveuglante
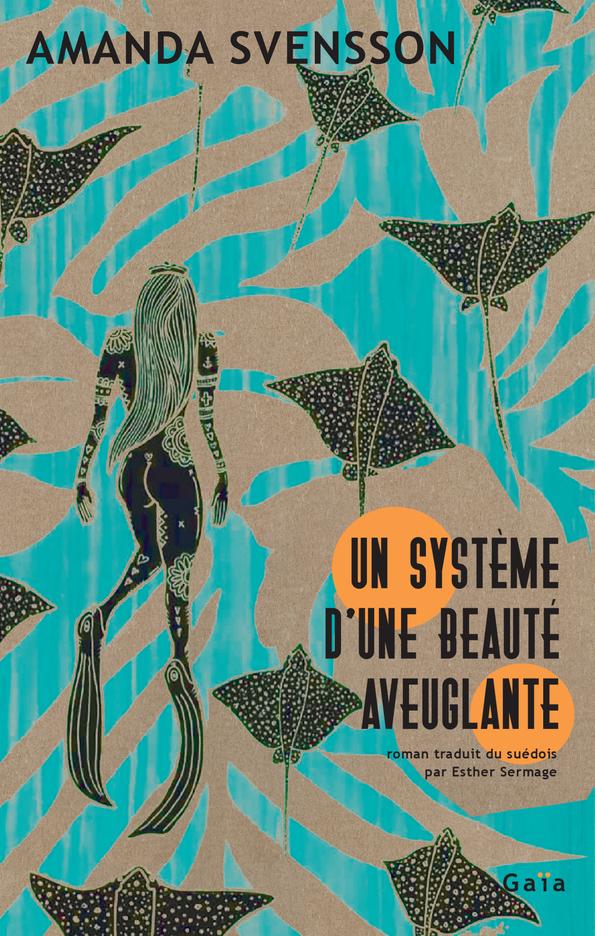
À Lund, en 1989, trois enfants naissent le même jour : Sebastian, Clara et Matilda. Des triplés. La vie va se charger de les séparer. Assisté d’une « guenon moraliste », Sebastian devient chercheur, à Londres, dans un institut d’études sur le cerveau dont les activités sont secrètes. Afin de retrouver un activiste écologiste, Clara se rend sur l’île de Pâques, au sein d’un groupe qui tente de vivre en autarcie dans le respect de la nature. Mathilda, « vingt-six ans ans, brune aux yeux bleus, tueuse de chien, poupée méchante et probablement échangée contre une autre à sa naissance, généralement domiciliée à Berlin », entend maintenant rentrer en Suède et vivre sereinement en famille. Signé Amanda Svensson (né en 1984), dont Actes sud avait publié Bienvenue dans ce monde en 2014, ce gros roman de six cent cinquante pages, Un Système d’une beauté aveuglante, est agréable à lire. Pourtant, cette chronique familiale inscrite dans les années 2020 semble faire du sur-place. Nous ne voyons pas où l’auteure veut en venir, sinon nous présenter quelques personnages représentatifs de l’époque et ni plus ni moins sympathiques que d’autres. Conter l’histoire des membres d’une famille ? « Une famille, c’est un système comme tous les autres (…). Son but est de nous apporter le réconfort et la stabilité. Mais ça n’a pas de sens si le système n’est pas investi de quelque chose de plus précieux. L’amour. La confiance. Ce genre de choses. Si ces liens-là existent, peu importe qui fait partie de la famille ni comment. » Nous les suivons, nous nous interrogeons bien volontiers avec eux, mais... en quoi représentent-ils une fratrie ? En quoi appartiennent-ils à une même famille ? La réponse est peut-être dans l’intrigue même de ce roman, puisque le postulat est que l’un des enfants a été échangé à la maternité. « ...Situation familiale insolite dans laquelle ils se trouvaient tous inopinément. » À présent, tous trois semblent égarés dans un monde trop grand pour eux et ce n’est pas leur mère qui les aide à y voir beaucoup plus clair, ni leur père depuis longtemps parti. La fin vient avec ses explications, toutes suffisamment farfelues pour rappeler la littérature d’aventure. Un roman trop bavard, nous semble-t-il.
* Amanda Svensson, Un Système d’une beauté aveuglante (Ett system så magnifikt att det bländar, 2019), trad. Esther Sermage, Gaïa, 20211
L’Évangile des anguilles
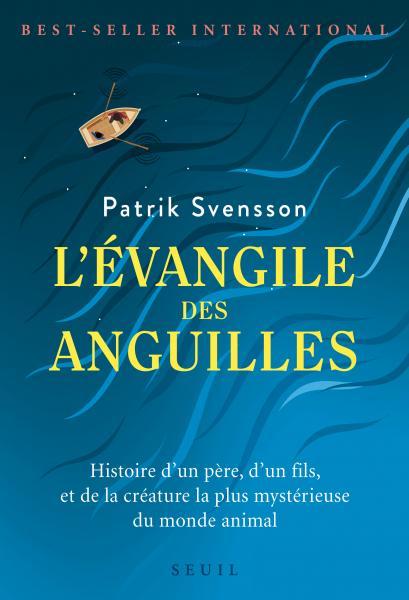
Il y a des livres qui, lorsque le lecteur les referme, lui donnent l’impression d’être moins bête. Comme celui de Patrick Svensson, L’Évangile des anguilles. Un roman, ou peut-être un essai tant cet ouvrage à l’image de son sujet se faufile entre les genres, qui commence par parler d’une espèce de poisson, en l’occurrence les anguilles, durant tout un chapitre. Puis qui emmène le lecteur avec le narrateur – l’auteur – et son père, aux quatre coins du globe : des côtes suédoises (l’anse de Hanö, à l’est de la Scanie) au Japon, de la Sicile au Pays basque. « ...Même si ce que nous savons désormais sur son cycle de vie – le long voyage depuis la mer des Sargasses, les métamorphoses, la patiente attente, le voyage du retour pour se reproduire et mourir – est sans doute exact, dans le détail cela reste en grande partie de l’ordre de la conjecture. » Mystère jamais totalement élucidé de l’anguille. L’intrigue de ce livre est des plus banales : les parties de pêche de l’enfant et de son ouvrier de père – « une identité transmise, héréditaire (…), son chemin était tracé dès l’origine » (entre l’anguille et l’ouvrier, même communauté de non-destin). On n’a jusqu’à récemment su que très peu de choses sur l’anguille, l’un des poissons (un poisson, oui, pas un serpent ni un batracien comme on l’a cru des siècles durant) les plus consommés pourtant de par le monde. On ne sait toujours pas tout avec certitude sur lui, tant il rechigne à se laisser domestiquer un minimum : pas d’élevage, de reproduction sous contrôle humain. L’anguille peut vivre des dizaines d’années, elle peut sembler morte et s’agiter soudain, surprendre le Renart que nous sommes et sautiller jusqu’à la première pièce d’eau à sa disposition – un étang, un lac, un fleuve ou l’océan, car elle peut vivre dans l’eau salée et dans l’eau douce. Étrange, étonnant animal. L’Évangile des anguilles a obtenu le prix August, plus prestigieuse récompense littéraire suédoise, et ce n’est que justice. Né en 1972, son auteur, Patrick Svensson, est journaliste spécialisé dans les arts, la culture et la recherche scientifique, un universitaire en rupture avec son milieu d’origine. « Mais l’été, je revenais toujours à la maison, au moins pour quelques jours, et nous descendions au bord de la rivière. » Que d’érudition et d’éclectisme dans ce livre, moins paisible qu’une partie de pêche : l’auteur ne tait pas les multiples façons d’attraper l’anguille (comme cette affreuse ligne composée de centaine de lombrics assemblés) ni de la tuer. Recommandons-en vivement la lecture avant d’observer attentivement cet animal appelé comme tant d’autres à disparaître – merci l’industrie halieutique, merci la folie des hommes.
* Patrick Svensson, L’Évangile des anguilles (Ålevangeliet, 2019), trad. Anna Gibson, Seuil, 2020
Un Été polaire

Ceux qui connaissent le romancier français Pierre Pelot retrouveront sans doute, dans Un Été polaire de la Suédoise Anne Swärd, semblable façon de mettre en scène un à un les personnages, des individus apparemment sans importance, en leur donnant la parole et en s’attachant à leurs menus traits de caractère (pensons, par exemple et parmi tant d’autres titres de Pelot, à Elle, qui ne sait pas dire je). Dans Un Été polaire, récompensé par le prestigieux prix August, Anne Swärd nous entraîne auprès de quelques personnages pas loin d’être des marginaux. Jack, le père, Ingrid, la mère, Kristian et Jens, les fils, Lisette, la belle-fille, tous gravitent, qu’ils le veuillent ou non, autour de Kaj, la fille adultérine, pourrait-on dire, au comportement un peu bizarre, qui a grandi là sans jamais prendre son envol, qui ne conçoit le monde qu’aux côtés de son cher Kristian. « Quand la brume s’est retirée dans les terres, Kaj descend sur la plage et y reste plusieurs heures. Elle passe plus de temps dans l’eau qu’à terre, son bikini blanc luit au creux des vagues. De l’étage, je peux garder un œil sur elle sans avoir à sortir au soleil. (…) Contre la mer, on ne peut pas protéger Kaj. » La famille se retrouve, le temps d’un été, se cherche, s’affronte, explose, jusqu’au drame. Anne Swärd nous livre un beau récit, le quotidien douloureux de ceux que l’on appelle les petites gens, faisant alterner avec poésie violence et tendresse dans la lumière crue d’un été suédois.
* Anne Swärd, Un Été polaire (Polarsommar, 2013), trad. Rémi Cassaigne, Buchet-Chastel, 2016
Docteur Glas et pasteur Gregorius
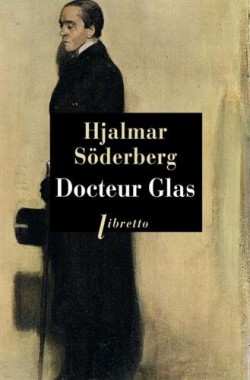
On connaissait le célèbre roman de Hjalmar Söderberg, Docteur Glas, aujourd’hui réédité pour l’occasion. Car voici que Bengt Ohlsson se charge de mettre en scène le principal, si l’on peut dire, personnage secondaire de cette œuvre, le pasteur Gregorius, époux d’Helga, qui le délaisse et suit les conseils du médecin de famille, le fameux Docteur Glas, lequel recommande au couple l’abstinence sexuelle. Certes bien plus âgé qu’Helga, Gregorious ne s’y résout pourtant pas et un sévère désarroi, d’ordre existentiel, le frappe, lui le religieux capable de s’interroger sur la théorie de l’évolution mais affirmant « c’est la volonté de Dieu » lorsque cela le dispense de trop d’efforts. « Ma prison, c’est d’être tenu par tous pour autre que ce que je suis. Ma prison, ce sont tous les désirs que je n’ai jamais osé exprimer. (…) Ma prison, c’est toute cette peine et tout ce désespoir que j’ai enfouis dans des cachettes si ingénieuses que je ne saurais jamais les retrouver, quand bien même j’essaierais. » Gregorious est en proie au doute sous toutes ses formes et à ce titre, il en devient presque sympathique. « Le péché », réfléchit-il, « c’est le fait de se priver d’être une personne aimante ». Pas mal, non ? Nos religieux actuels de tous poils seraient bien avisés de décortiquer cette idée. Mais lorsque Gregorious évoque son attirance pour celle qui deviendra sa femme, le malaise apparaît. Elle a douze ans, lui une quarantaine d’années. Il l’observe un jour à la dérobée. Elle est nue devant le miroir d’une armoire, touche son propre corps, l’explore. « Ce devait être un péché si grave que l’idée n’avait pas dû effleurer Dieu de le faire figurer parmi Ses commandements. Il avait dû estimer que l’interdiction de convoiter la femme de son prochain suffirait et que personne, et surtout pas un de ses serviteurs, ne tomberait assez bas pour désirer l’enfant de son prochain. » Sur les conseils, donc, du Docteur Glas, qui a vraisemblablement des idées derrière la tête, Helga se refuse à lui. Gregorious prend du poids, il est d’humeur taciturne, on se détourne de ce pasteur si peu avenant. Il tente cahin-caha de reprendre sa vie en main mais jusqu’à la dernière page le lecteur a envie de le secouer, de l’enguirlander.
Bengt Ohlsson réussit là son pari de tracer le portrait d’un personnage emprunté à l’un de ses grands prédécesseurs. Méconnu en France bien que plusieurs de ses livres soient ou aient été disponibles (La Jeunesse de Martin Birck, Le Jeu sérieux, etc.), Hjalmar Söderberg (1869-1941) est toujours très lu en Suède, où il fait figure de classique. (Rappelons que les éditions Cambourakis ont publié de lui Dessin à l’encre de Chine et autres nouvelles en 2014.)
Né en 1963, chroniqueur au quotidien Dagens Nyheter, Bengt Ohlsson est l’auteur de plusieurs romans, dont, traduits en français, Syster (Phébus, 2011) et Kolka (Phébus, 2012). Deux romans subtils et puissants.
* Bengt Ohlsson, Gregorius (Gregorius, 2004), trad. Rémi Cassaigne, Phébus, 2016
* Hjalmar Söderberg, Docteur Glas (Doktor Glas, 1905), trad. Marcellita de Moltke-Huitfeld et Ghislaine Lavagne, Libretto, 2016
(Reprise ici de la traduction de 1969 de Doktor Glas, Julliard, 1969 – qui était indiquée comme « traduit du danois » et comprenait une préface de Jean-Clarence Lambert ; notons qu’en 2005 les éditions Michel de Maule ont publié une traduction « sans suppressions ni résumés » de Denise Bernard-Folliot, sensiblement différente de la précédente.)
Petit traité de taxidermie

Petit traité de taxidermie n’est pas un manuel à l’usage des chasseurs. Ouf ! Ni des zoologues. Signé Maja Thrane (née en 1974, journaliste culturelle notamment pour le quotidien Svenka Dagbladet et traductrice), ce curieux petit livre n’est pas un roman à proprement parler, ni vraiment un récit. Plutôt une suite de petits tableaux. Il y a pourtant une action, et des personnages fictifs et réels l’animent. Comme August Wilhelm Malm (1821-1882), qui fut directeur du Musée d’histoire naturelle de Göteborg et auteur de nombreux articles sur la taxidermie et les cétacés. L’homme a laissé trace dans l’histoire pour avoir cru découvrir une espèce nouvelle de baleine. Quand l’une s’est échouée sur une plage de la région, il l’a exposée, après l’avoir faite empaillée, dans une salle du Musée – jusqu’à ce que l’on s’aperçoive que l’animal appartenait à une espèce courante, la baleine bleue. De nos jours, dans la maison dans laquelle il vécut, un jeune couple s’installe, des amis leur rendent visite. Passé et présent se mêlent. Björn et Vera sont conscients de prendre le relais, non pas uniquement de August Wilhelm Malm, mais de tous les individus qui habitèrent là. « Nous vivons à travers ce que nous voyons, le bien que nous faisons et ce que nous redoutons. Nous vivons à travers les traces que nous laissons chez les autres. » Un livre aussi simple que déconcertant. Observons que le logo des éditions Agullo s’accompagne d’un slogan : « Abolir les frontières ». À interpréter comme on le souhaite, le premier degré nous satisfait déjà grandement. Longue vie !
* Maja Thrane, Petit traité de taxidermie (Anvisning att konservera naturalier, 2019), trad. Marie-Hélène Archambeaud, Agullo (Court), 2022
Amatka

« Dorénavant, ils étaient ici, dans le nouveau monde, et ils avaient bâti la société idéale. » Vanja de Brilar d’Essre Deux est envoyée dans la colonie d’Amatka pour effectuer une étude de marché. Car les colonies sont chacune affectées à une production précise. Mais Vanja et Nina, qu’elle retrouve, sont surprises par les contradictions qu’elles découvrent dans le discours officiel. Personne ne sait trop « où se trouvait l’ancien monde, ni même à quoi il ressemblait, mais ça n’avait aucune importance ». D’ailleurs, « personne ne sait où nous sommes. Mais on n’a pas le droit de le dire. » La vie à Amatka est très policée. Les enfants sont séparés des parents, ceci, afin ne pas perdre de vue la dimension collective du monde nouveau. Une certaine paranoïa est entretenue, on ne sait trop d’abord pour quels desseins. « Il était de notoriété publique que le monde, hors des colonies, était dangereux. » Vanja apprécie la vie ici, surtout depuis qu’elle s’est rapprochée de Nina. En dépit des mises en garde à mots couverts d’Evgen, un bibliothécaire, elle décide de démissionner de son poste à Essre pour intégrer un emploi dans l’administration à Amatka. Mais bientôt, elle comprend que le monde d’Amatka repose sur un ensemble de faux-semblants. Née en 1977, Karin Tidbeck semble être une plume prometteuse de la science-fiction suédoise d’aujourd’hui. Quelque part entre La Kallocaïne de Karin Boye et Aniara de Harry Martinson, Amatka devrait séduire les amateurs d’une SF que l’on qualifiera de dystopie.
* Karin Tidbeck, Amatka (Amatka, 2017), trad. Luvan, La Volte, 2018
Le Chronométreur
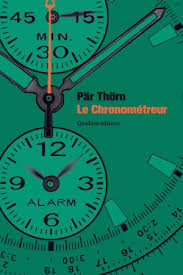
Le temps, c’est de l’argent. Nous le savons tous et cela n’empêche, le temps, nous nous en trouvons si souvent dépossédé. Lui rendre sa gratuité – sa liberté –, c’est peut-être se donner les moyens d’en jouir à nouveau, seul luxe, à vrai dire, à portée de main. Mais ce n’est pas du tout le but que poursuit le personnage principal du livre de Pär Thörn, Le Chronométreur. Armé, donc, d’un chronomètre, petit instrument de torture psychologique, celui-ci calcule le temps que prennent diverses actions, dont, évidemment, celles effectuées contre rémunération – autrement dit pour un salaire. « Je chronomètre des modèles de mouvements. Les modèles de mouvements sont définis comme des opérations de travail. » Il va de soi que ses collègues n’apprécient pas plus que cela sa présence à leurs côtés mais il n’en a cure, il poursuit son œuvre, répertorier les durées des gestes du travail les plus courants. Né en 1977, Pär Thörn réside à Berlin depuis quelques années et exerce le métier de « performeur sonore ». Influencé par les Oulipiens français, il a déjà signé plusieurs ouvrages. Le Chronométreur est une œuvre assez inclassable, entre, peut-être, le roman prolétarien à la Mats Berggren (cf. Ni l’un ni l’autre, L’Élan, 1996) et… le catalogue IKEA. On peut évidemment aussi penser à Kafka ou, plus récemment et côté suédois, à Jonas Karlsson, dont le petit roman intitulé La Facture plongeait également le lecteur dans un univers étrangement quotidien et cependant anxiogène au possible. Au rebours de certains critiques, nous n’affirmerons pas que Le Chronométreur (personnage qui se voit lui-même comme « un nuage noir ») est un livre « hilarant », que non, mais il ne peut que nous inciter à une salutaire réflexion sur le salariat et ses conditions trop souvent peu humaines. « Ma vie est simple, logique et mesurable, mais parfaitement normale. L’aliénation est une donnée de base de notre vie. Rien d’autre qu’une donnée de base mesurable de notre vie. Pas d’abracadabra. »
* Pär Thörn, Le Chronométreur (Tidsstudiemannen, 2008), trad. Julien Lapeyre de Cabanes, Quidam, 2017
Le Destitué

Serait-il faux d’affirmer que Birgitta Trotzig (1929-2011) est un peu la Marguerite Yourcenar suédoise ? Catholique convaincue, elle trouve souvent l’inspiration dans l’histoire de son pays. Le Destitué est un petit roman (publié initialement en France par Gallimard en 1963) d’une écriture remarquable et, en dépit du sujet, d’une lecture presque haletante. Une plongée dans la Suède du XVIIe siècle, dans une région, la Scanie, qui passe tour à tour sous domination danoise et suédoise. Pour le plus grand malheur de ses habitants, à l’exception évidemment de quelques-uns, qui se rallient aux puissants du moment. Un jour, le pasteur est destitué parce qu’il aurait été bienveillant avec l’ennemi. S’ensuit pour lui un terrible chemin de croix, qui lui donnera l’occasion, ou ainsi le ressent-il, de se rapprocher de Dieu. « ...Parfois, à la faveur de certains éclairages, vu de loin ou de côté, quand il se tenait dans l’ombre ou quand la lumière éclairait sa joue de profil, sa paupière, son front, ses rides effacées, la gerçure de sa joue, le visage du destitué ressemblait à celui d’un enfant... » Inutile d’être croyant pour partager avec lui l’épreuve de la mendicité dans un pays subissant la misère. L’écriture flamboyante de Birgitta Trotzig entraîne le lecteur dans ce tourbillon.
* Birgitta Trotzig, Le Destitué (De Utsatta, 1957), trad. Jeanne Gauffin, préf. C. G. Bjurström, Le Rocher (Motif), 2008
L’Affaire Nobel
Après Le Cartographe des Indes boréales, époustouflant roman, Olivier Truc nous offre un livre consacrée à ce qu’il faut bien appeler L’Affaire Nobel. Revenant sur le démarrage de ce scandale, viols et harcèlement sexuel de plusieurs femmes par le français Jean-Claude Arnault, par ailleurs époux de la poétesse Katarina Frosteson, membre de l’Académie suédoise, l’auteur montre en quoi il a atteint profondément la société suédoise. Donné de manière abusive comme la « dix-neuvième voix » de l’Académie suédoise, qui décerne chaque année le Prix Nobel de littérature, Arnault profite de son statut pour vivre grassement et menacer les femmes qui refuseraient ses visées. Rien, hélas, d’exceptionnel. Si ce n’est que l’Académie va se scinder en deux à cause de lui. Faut-il remettre son cas entre les mains de la police ou tenter de le régler en interne ? Jour après jour, la situation se tend, comme le montre Olivier Truc. « Cette affaire me semble hors norme. Je n’en reviens pas. » Horace Engdahl, académicien m’as-tu-vu et auteur de platitudes que Jean-Claude Arnault « doit tenir d’une manière ou d’une autre », va mener la défense du couple Arnault-Frostenson. Kjell Espmark, Klas Östergren et Peter Englund s’indignent, rappelant que « l’intégrité est l’élément vital de l’Académie ». Ou devrait l’être. Au travers de cette enquête très contextualisée, Olivier Truc (qui explique sa propre relation à la Suède) s’interroge sur la société suédoise au fil du temps, des migrations vers les États-Unis au XIXe siècle à la conversion de la social-démocratie au social-libéralisme à partir des années 1980. L’histoire du Prix le plus prestigieux du monde (avec le Prix Nobel de la Paix) est retracée et l’on comprend pourquoi August Strindberg en fut évincé au profit de notabilités des Lettres oubliées de tous aujourd’hui. « La réputation de la Suède ne serait-elle qu’un vaste malentendu ? » interroge Olivier Truc. Avec ses fastes et ses dépenses hors de tout contrôle, l’Académie suédoise était un anachronisme dans la Suède d’aujourd’hui – ou on peut l’espérer. Le scandale qui l’a éclaboussé n’est donc guère si surprenant. Excellent romancier, Olivier Truc est aussi un journaliste hors-pair, pour preuve cette enquête.
* Olivier Truc, L’Affaire Nobel, Grasset, 2019